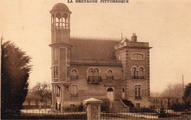|
Langoëlan
Langoëlan [lɑ̃ɡwɛlɑ̃] est une commune française, du canton de Gourin, située dans le département du Morbihan en région Bretagne. ToponymieLa forme écrite en breton de la commune est Laoulan. Le nom de la localité est mentionné sous les formes Langouelan en 1448, en 1464, en 1477 et en 1481 ; Langouellan en 1513 ; Lanvoellan en 1536[1] ; Langoeslan en 1793 ; Langoelan en 1801[2]. Cette graphie, correspondant à la forme orale en breton populaire, est attestée à l'écrit de manière ancienne également. Notamment par le nom du journal paroissial Bro Laoülan[3] édité dès les années 1900, dans les écrits de l'écrivain du Pays Pourlet Gwilham er Borgn (1866-1927), du Bleun-Brug, ou par Pierre Le Padellec fondateur du Kan ar Bobl, dans la revue Mil-Bouton édité par l'association Kafe Bara Amonenn[4] qu'il dirigeait. D'autres formes ont pu être utilisées en breton comme Leuelan, Leuelann, Laoulann ou encore Lanwelan. Cette dernière forme avait été retenue par l'Office de la langue bretonne, ou par le linguiste Hervé Abalain[5]. Mais ce choix était vivement contesté par les élus locaux, des associations, et des habitants[6],[7]. La forme Laoulan ou Laoülan restait d'ailleurs usitée par Skol Vreizh[8], Bretagne Culture Diversité[8], Dastum[9], dans les médias tels que Radio Bro Gwened[10], France 3 Bretagne[11], France Bleu Breizh Izel[12], ou par les entreprises et associations locales[13]. Une délibération du conseil municipal a finalement été votée à l'unanimité le 1er mars 2023 et indiquait Laoülan comme nom écrit en breton[14]. Le conseil scientifique de L'Office public de la langue bretonne, présidé par le lexicographe Francis Favereau, a voté à l'automne 2023 en faveur de la graphie Laoulan, sans tréma[réf. souhaitée]. Le suffixe lann permet de dater la fondation de la paroisse au haut Moyen Âge. Lann est défini comme un lieu de culte chrétien, il s'agit aussi, à l'époque d'une entité locale bretonne christianisée en entité administrative religieuse. Elle est suivie par gowelañ qui signifie pleurer[15]. Origine qui peut provenir de l'histoire locale liée à la mort du roi Salomon[réf. souhaitée]. GéographieLocalisationLangoëlan est situé dans le nord-ouest du département du Morbihan. La commune appartient d'un point de vue administratif à la communauté d'agglomération du Pays du Roi Morvan et à l'arrondissement de Pontivy. Elle appartient par ses traditions au Pays Pourlet et à la Basse Bretagne. Le bourg de Langoëlan est situé à vol d'oiseau à 19,5 km à l'ouest-nord-ouest de Pontivy et à 62,7 km au nord-ouest de Vannes. Relief et hydrographieLa commune est traversée du nord au sud par le Scorff, rivière qui prend sa source à 5 km au nord du bourg, au village de Saint Auny, au pied de Mane Skorn, sur la commune de Mellionnec. La commune s'étend sur 2 227 hectares dont 386 hectares de bois[16]. Le bourg est situé sur une colline qui culmine à 202 mètres d'altitude. Le bourg domine à l'ouest la vallée du Scorff et à l'est l'étang du Dordu. Au nord de la commune, le bois de Coët-Codu couronne une colline qui culmine à 274 mètres et constitue le plus haut sommet de Langoëlan. ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat océanique franc, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[17]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans une zone de transition entre les régions climatiques « Finistère nord » et « Bretagne orientale et méridionale, Pays nantais, Vendée »[18]. Parallèlement l'observatoire de l'environnement en Bretagne publie en 2020 un zonage climatique de la région Bretagne, s'appuyant sur des données de Météo-France de 2009. La commune est, selon ce zonage, dans la zone « Monts d'Arrée », avec des hivers froids, peu de chaleurs et de fortes pluies[19]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,9 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 12 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 078 mm, avec 15,8 jours de précipitations en janvier et 8,1 jours en juillet[17]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Plouay à 24 km à vol d'oiseau[20], est de 11,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 149,0 mm[21],[22]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[23]. UrbanismeTypologieAu , Langoëlan est catégorisée commune rurale à habitat très dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[24]. Elle est située hors unité urbaine[25] et hors attraction des villes[26],[27]. Occupation des sols Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).
Morphologie urbaineLa population se disperse, outre le bourg, dans environ 60 lieux-dits ou écarts. 57 villages sont attestés dès le XVe siècle[29]. La plupart des écarts sont de simples hameaux constitués de deux ou trois maisons mais d'autres sont plus importants comme le village de Quénépévant qui comptait 141 habitants en 1851 soit presque autant que le bourg de Langoëlan qui en comptait 144 à la même époque. Liste des lieux-dits
LogementEn 2020 on recensait 358 logements à Langoëlan. 191 logements étaient des résidences principales (53,4 %), 110 des résidences secondaires (30,9 %) et 56 des logements vacants (15,7 %). Sur ces 358 logements, 351 étaient des maisons contre 4 seulement des appartements . Sur les 191 résidences principales, 78 avaient été construites avant 1919, soit un taux de 41,0 %. Le tableau ci-dessous présente la répartition en catégories et types de logements à Langoëlan en 2020 en comparaison avec celles du Morbihan et de la France entière.
HabitatLe bourgLe bourg se présente comme un village-rue qui s'étire le long de la départementale 3 selon un axe nord-sud. Celui-ci s'est développé autour de l'église paroissiale qui date du XVIe siècle. À l'exception du presbytère qui date du XVIe siècle et d'une maison à l'ouest de l'église qui date du XVIIe siècle, l'ensemble du bâti a été reconstruit au XIXe siècle, la rectification de la route de Guémené à Rostrenen qui traverse le bourg ayant entraîné la destruction de nombreuses maisons. L'école, construite à la toute fin du XIXe siècle au sud du presbytère, fait aujourd'hui office de mairie. Deux maisons exceptionnelles par leur architecture ont été construites au XXe siècle dans le bourg : la maison Haïk et la maison Le Corre[33]..
Les hameauxDe nombreux hameaux conservent un bâti ancien utilisant des matériaux locaux (granite sur la commune de Langoëlan) : Restermen, Penpoulquio, Canquiscren, Cauraden, Quénépévant, Taleros. Sur certaines maisons sont indiqués la date de construction et le nom du maître d'ouvrage comme à Quénépévan et Canquiscren. On compte aussi plusieurs moulins bien conservés tel celui de Tronscorff. Il y a aussi plusieurs manoirs : Tronscorff, Le Reste, Le Plessis.
HistoirePréhistoireNéolithiqueL'occupation du territoire communal est ancienne comme l'atteste la présence d'un dolmen daté de 4 000 av. J.-C. à La Villeneuve, appelé Ty ar Koriganed (la Maison des Korrigans). Âge du bronzeUne tombe de l'Âge du bronze près du village de Saint-Houarno a été fouillé vers 1970. Deux autres sites funéraires datant de l'Âge du bronze ont été identifiés : le tumulus de Kerservant et la nécropole du Cosquer[29]. Par ailleurs un dépôt d'objets en bronze contenus dans une poterie a été découvert en 1981 par un cultivateur au lieu-dit Botcazo. Le dépôt, daté de la fin de l'Âge du bronze (1000 à 800 av. J.-C.), renfermait des bijoux (un collier de 115 perles pesant 200 g, 5 bracelets dont un bracelet orné avec des bouts à « tampon » de 80 g de forme elliptique), des outils (7 haches, 4 racloirs, 1 crochet à viande et des accessoires d'habillement et de harnachement) ainsi que des armes (une pointe de lance, un talon de lance, une virole de pommeau d'épée, un fragment d'une épée en « langue de carpe »). Il y avait aussi quelques débris d'objets et des lingots en bronze et certains en cuivre. Certains lingots contenaient aussi du plomb et de l'argent. Au total le dépôt pesait 4 kg[34]. Âge du ferUn souterrain de l'Âge du fer a été fouillé au bourg en 1973[29]. AntiquitéLe territoire est traversé par la voie romaine nommée Hent Ahès qui relie Castennec à Vorgium, dont le tracé est encore bien perceptible entre Le Merzer et Le Coledic Vraz[29]. Moyen-Âge et Temps ModernesAu lieu-dit de Talhouët, une campagne de sondages et de relevés topographique a permis de mettre au jour une enceinte fortifiée bâtie à la fin du VIIe siècle, et remaniée durant le Xe siècle[35]. Meurtre du roi SalomonDans la nuit du 24 au 25 juin 874, le roi de Bretagne Salomon, qui avait été livré par des comtes bretons (dont son gendre Pascweten et Gurwant, gendre d'Erispoë) à des seigneurs francs, fut supplicié par ces derniers en un lieu-dit appelé le Merzer (le Martyr en français), situé probablement en Langoëlan. Il fut contraint d'assister au meurtre de son jeune fils Wigon, avant d'avoir lui-même les yeux crevés. Son corps, retrouvé sans vie le lendemain matin, fut inhumé, conformément à ses vœux au monastère de Plélan, auprès de son épouse Wenbrit[36]. Les paroisses de Langoëlan et Le MerzerLa paroisse de Langoëlan, dont le nom est mentionné pour la première fois dans un document de 1268, est de constitution ancienne comme l'indique le préfixe Lan, ayant le sens de ermitage ou monastère. Cependant une partie de son territoire actuel dépendait d'une autre paroisse nommée Le Merzer mentionnée au XIVe siècle ; les deux paroisses sont cependant unies dès la fin du XIVe siècle, bien qu'en gardant leur autonomie : l'église de Le Merzer avait son cimetière où l'on enterra jusqu'en 1817. La partie ouest de la paroisse de Le Merzer, qui comprenait le village de Kerservant, sera détachée de Langoëlan et rattachée à Ploërdut après la Révolution[29]. Les seigneuriesÀ l'époque féodale, plusieurs seigneuries se partageaient le territoire de Langoëlan. La plus importante d'entre elles était celle de Coëtcodu. Après avoir appartenu aux Coëtuhan et aux Penhoët, elle échut aux du Fresnay à la suite du mariage de Guillaume du Fresnay avec Béatrice de Penhoët. Puis elle passa aux Guimarho, aux Perenno et finalement aux Le Vicomte. La seigneurie de Coëtcodu possédait les droits de haute justice à Langoëlan, tenait ses plaids généraux le 12 juin et disposait de fourches patibulaires à Park en Justis. Par ailleurs ses seigneurs se déclaraient prééminenciers et supérieurs de l'église saint-Barnabé où ils avaient droit de banc et droit d'afficher leurs armes. Les seigneurs de Kerservant en Ploërdut avaient aussi droit de justice et fourche patibulaire et leurs armes figuraient aussi dans l'église paroissiale. Les sieurs de Tronscorff étaient les vassaux de ces derniers[37]. Le XVIIIe siècleJean-Baptiste Ogée décrit ainsi Langoëlan en 1779 :
Le XXe siècleLa Première Guerre mondiale Le monument aux morts de Langoëlan porte les noms de 84 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 3 (Pierre Joseph Fourdan, Louis Marie Le Berre, Barnabé Pasco) sont morts en Belgique ; 1 (Marc Le Dantec) est mort en Grèce ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français. Le premier à être tombé sur le champ d'honneur est Barnabé Pasco le 22 août 1914 à Maissin en Belgique[39].  Albert Haïk, entrepreneur de travaux publics à Paris, né à Tunis en 1885, fait construire à la fin des années 1920 dans le bourg à la demande de son épouse Marie-Louise Le Nouveau qui est née à Langoëlan en 1889 une maison détonnant par son architecture pour le moins originale et qui n'est pas sans rappeler les constructions mauresques ce qui lui vaut le surnom de "Château de l'émir". La construction utilise des matériaux variés et pour certains novateurs : béton, brique, moellon enduit imitant la pierre de taille. La partie la plus originale de l'édifice est une tourelle circulaire servant de belvédère couverte d'un dôme de ciment. La demeure est aussi surnommée "Château Haik" du nom de son commanditaire. Riche et généreux, il a offert à l'église une cathèdre d'origine auvergnate d'une grande valeur ainsi que des statues et les personnages d'une magnifique crèche. La maison sera occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale[40].  La Seconde Guerre mondiale Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1944, la section FFI de Langoëlan-Mellionnec dirigée par François Le Guyader était composée d'une vingtaine de résistants ; au cours de la journée du , le village de Kergoët, situé à 2 km au nord du bourg de Langoëlan, fut le théâtre de combats acharnés entre l'armée allemande et la compagnie résistante FTPF locale, dirigée par Désiré Le Trohère ("capitaine Alexandre"). Les Allemands subirent de lourdes pertes puisque 35 de leur soldats périrent et 60 à 70 autres furent blessés. Parmi les victimes du côté français, un civil, Joseph Le Padellec, patron de ferme dans ce village, fut sauvagement frappé puis abattu par les soldats allemands ; les résistants perdirent 5 ou 6 hommes (dont Le Gouar, Le Padellec, Pimpec : leurs corps furent retrouvés calcinés dans la ferme incendie des époux Le Padellec) , ainsi qu'un parachutiste SAS, Fernand Bonis ("Bonneau" dans la résistance)[41]. Des membres de la famille Baucher, du village Petit-Rose en Silfiac, soupçonnés d'avoir dénonce les maquisards, furent sommairement exécutés le par des FFI sans que leur culpabilité soit établie avec certitude[42].
La guerre d'IndochineDeux soldats originaires de Langoëlan sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine : Louis Marie Palaric à Hanoï le 12 août 1950 et Pierre Joseph Le Guevel le 17 mai 1951 à Nhatrang[39]. Le XXIe siècleEn 2019, la construction de poulaillers géants suscite l'opposition d'une partie des habitants[43]. Politique et administration DémographieL'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[46]. En 2022, la commune comptait 404 habitants[Note 1], en évolution de +6,32 % par rapport à 2016 (Morbihan : +3,82 %, France hors Mayotte : +2,11 %). Lieux et monumentsMonuments préhistoriques
Édifices religieuxElle date du XVIe siècle[1] et a été remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle comprend une nef sans bas-côtés, un transept et un chœur à chevet plat ; les deux chapelles latérales sont sous le vocable du Rosaire et de saint Salomon. Chapelle Saint-ServaisLa chapelle Saint-Servais édifiée au XVIe siècle, fut entièrement remaniée vers 1760. Son choeur polygonal, sa sacristie, ses portes et fenêtres plein cintre, son modeste clocher, sont caractéristiques de cette époque. L'édifice fut endommagé à la Révolution. En 1923, le recteur interrompt le pardon pour une restauration urgente avec notamment la construction de 3 contreforts soutenant le mur nord. Depuis 1990, l'édifice tout comme sa fontaine-mur à pignon triangulaire ont fait l'objet de restaurations régulières. À l'intérieur, le choeur, délimité par une clôture, abrite un autel en pierre et trois niches où trônent les statues de Saint Servais (XVIe siècle), d'une sainte appelée localement Marie Madeleine (XVIIe siècle) et de Sainte Marthe dite Sainte Geneviève (XVIIe siècle). La statue de Saint Efflam en granite et la cloche en bronze (1812) proviennent de la chapelle voisine Saint Efflam, tombée en ruine vers 1920. On y honore Saint-Servais, un des saints de glace, dont le pardon avait lieu autrefois le 13 mai et maintenant le second dimanche d'août[48].
Chapelle Saint-HouarnoLa chapelle Saint-Houarno est caractéristique des années 1500 avec ses contreforts biais et sa plinthe moulurée à la base des murs. En ruine en 1802, elle est remaniée au XIXe siècle : pente de toit abaissée, charpente remplacée, remplage de la maîtresse-vitre et pinacles des contreforts détruits, porte nord murée, clocher et sacristie ajoutés. L'édifice conserve au sud une porte en accolade chargée de feuilles frisées formant un arc brisé et au nord une porte ornée de moulures et coiffée d'une accolade à haut fleuron. Saint Houarno ou saint Hervé est à l'honneur tant dans le vitrail que dans sa statue. Aveugle de naissance, il est entouré de ses deux guides : Guiharan et le loup qu'il apprivoisa après que ce dernier est dévoré son âne. On venait le prier au XIXe siècle pour se protéger des loups avant que ne se développe le pardon des chevaux en 1912.
Chapelle Notre-Dame de LocmariaLa chapelle de Locmaria fut édifiée au début du XVIe siècle. A l'ouest le mur-pignon à clocher est épaulé de contreforts biais et ouvert par un portail richement sculpté associant accolade sous archivolte avec pinacles et fleurons. On accède à la chambre des cloches ornée de masques par un escalier sur le rampant. A l'intérieur la chapelle a conservé son sol dallé, deux bénitiers aux portes sud et ouest et une crédence en arc brisé. Au XIXe siècle et XXe siècle, les travaux ont modifiés son aspect : sablières (XVIe siècle), clôture, et boiseries du choeur déposées, autel détaché du chevet, enduits enlevés, lambris refaits, vitraux ajoutés. De part et d'autre de la maîtresse-vitre trônent une vierge à l'enfant et un Christ souffrant. Un Ecce Homo provient de la chapelle détruite de Lochrist, tout comme deux statues de saint Laurent et saint Etienne datant fin XVIe siècle début XVIIe siècle, attribuables au même sculpteur.
Chapelle de la Trinité à QuénépavanLa chapelle de la Trinité dépendait de la proche seigneurie de Tronscorff et fût édifiée au XVIe siècle comme l'indique le décor de la porte sud en anse de panier et la maîtresse-vitre à l'Est. Construite en grand appareil régulier elle est caractéristique des chapelles bretonnes avec son plan rectangulaire et son mur pignon à clocher comportant une chambre des cloches ajourée sur les quatre faces cardinales à laquelle on accède par un escalier sur le rampant du nord. L'édifice conserve une riche statuaire abritée derrière la balustrade du choeur : une sainte Trinité avec le Saint-Esprit symbolisé par une colombe, un saint julien cavalier en armure (XVIe siècle) reposant sur une console sculptée en granite, un saint Joseph formant un ensemble avec une vierge à l'enfant. Un groupe de Saint Yves, entouré du riche et du pauvre, orne le mur nord.
Autres édificesManoir du Coledic BrazLe manoir du Coledic Braz, isolé à l'ouest de la commune, il date du XVIIe siècle, il est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel[49]. Manoir du PlessisLe manoir du Plessis date des XVIe et XVIIe siècles, est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel[50]. Manoir du RestLe manoir du Rest date de la deuxième moitié du XVIIe siècle ou de la première moitié du XVIIIe siècle, il est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel[51]. Manoir de TronscorffLe manoir de Tronscorff date des XVIIe et XVIIIe siècles, le logis est remanié au XIXe siècle. Il est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel[52]. Château et maison dans le bourgLe bourg de Langoëlan possède deux édifices remarquables par leur architecture: le château de l'émir et la maison Le Corre.
 Autres monuments
Site naturel
Personnalités liées à la commune
Notes et référencesNotes
Références
Voir aussiBibliographie
Articles connexesLiens externes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia