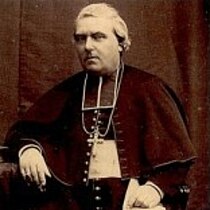|
Eudoxe Irénée Mignot
Eudoxe Irénée Mignot, né le à Brancourt-le-Grand et mort le à Albi, est un prélat catholique français, évêque de Fréjus puis archevêque d'Albi. Comme Bonomelli (it) en Italie, il symbolise en France l'ouverture de l’Église catholique à la société et à la culture moderne du XXe siècle. L'historien Émile Poulat le caractérise comme un intellectuel et un progressiste à la fois exceptionnel et discuté pour son rôle dans la crise moderniste. Biographie Eudoxe Irénée Mignot est né le à Brancourt-le-Grand dans l'Aisne d'un père instituteur et commence ses études au petit séminaire de Soissons. Il poursuit sa formation au séminaire Saint-Sulpice de Paris avant d'être nommé vicaire de ville à Saint-Quentin en . Il est ordonné prêtre d'Arras en [1]. Professeur de séminaire à Liesse, il est desservant de Beaurevoir en puis, en , aumônier de l’Hôtel-Dieu de Laon, ensuite curé de Coucy-le-Château () puis de La Fère ()[2]. Nommé vicaire général de Soissons en , évêque de Fréjus en , il accède finalement à l'archiépiscopat d'Albi en . Il meurt le à Albi[3]. Ses funérailles sont présidées par Jean-Augustin Germain, archevêque de Toulouse, entouré de dix archevêques ou évêques et de trois cents prêtres. C'est l'archevêque d'Auch qui célèbre la messe et Halle, auxiliaire de Montpellier et proche de Mignot qui prononce son oraison funèbre. Eudoxe Mignot est inhumé dans un caveau de la cathédrale Sainte-Cécile. PenséeC'est au séminaire Saint-Sulpice qu'il va se forger sa propre identité, notamment grâce aux professeurs Arthur Le Hir et Jean-Baptiste Hogan (en) qui l'initient à l'exégèse critique. Cependant, c'est seulement en arrivant à Fréjus qu'il peut faire entendre sa voix sur la question biblique. Ainsi, il publie en une préface où il affirme que la foi n'a rien à craindre de la critique historique et qu'il serait bon d'enfin l'accepter. D'une manière générale, il considère que le monde dit « moderne » n'est pas a priori hostile au catholicisme et estime que les vieilles recettes — il est notamment circonspect à l’égard du néo-thomisme — mènent à des impasses[2]. Ce n'est pas en arrivant à Albi qu'il renonce à ses idées puisqu'il écrit les Lettres sur les études ecclésiastiques, inspirées des Clerical Studies de Hogan et dans lesquelles cet autodidacte lecteur de Louis Figuier[4] partage ses idées sur la formation intellectuelle des clercs[2], et qu'il prononce en un discours à l'institut catholique de Toulouse qui lui permet d'asseoir son autorité sur la question théologique[5]. En relation avec Friedrich von Hügel, lecteur du cardinal Newman ou encore de George Tyrrell[2], souhaitant que « les catholiques ne restent pas en dehors du mouvement général de leur temps »[6], il prend la défense de l'abbé Loisy et de son ouvrage L’Évangile et l’Église qui sera mis à l'index en par le pape Pie X. Il accepte de faire acte de candidature à l'Académie française, mais se retire devant celle du cardinal de Cabrières pour éviter une division de l'épiscopat français[7]. Par principe assez libéral et respectueux de la pensée d'autrui, ses efforts n'empêchent pas la condamnation de Loisy ou l'éviction de Prosper Alfaric du séminaire d'Albi[2]. Il poursuit ses requêtes auprès du Vatican pour obtenir le pluralisme théologique primordial pour lui, mais sans succès. Il est atteint par l'encyclique Pascendi, une condamnation qu'il décrit comme « une grosse épreuve pour les âmes intelligentes et sincères »[8]. Bien que déconcerté, ce « novateur »[9] réagit par un article publié en dans Le Correspondant qui offre une réflexion globale sur les rapports entre l'Église et la science et où il affirme sa conviction que la Révélation et la science n'entrent pas en contradiction, étant l'une et l'autre œuvres de Dieu[10]. Selon lui, les thèses de la critique solidement argumentées s'imposeront progressivement sans mettre la foi en péril et les savants catholiques doivent continuer de travailler sans céder à la peur des publications vaticanes, avec patience et prudence[10]. Regrettant la condamnation de Dreyfus, hostile à l'Action française et défenseur du Sillon, Mignot est, selon l'historien Émile Poulat, un prélat à la fois « exceptionnel et discuté », « un intellectuel et un progressiste […] qui se distingu[e en cela] de l'épiscopat français dans son ensemble » mais aussi « [apparaissant] compromis dans la crise moderniste par son amitié avec Loisy[11] ». L'historien Jean-Marie Mayeur a dit de Mignot qu'il était l'« Érasme du modernisme »[12] et il peut être considéré comme l'un des précurseurs du rapprochement entre l'Église catholique et la société moderne. DistinctionŒuvre
ArmesTranché d'or à la croix potencée de gueules et d'azur à la branche d'olivier d'argent[14]. Notes et références
Voir aussiBibliographie
Articles
Article connexeLiens externes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia