|
BiomarqueurUn biomarqueur est une caractéristique biologique mesurable liée à un processus normal ou non[1]. Dans le domaine de l'écologie, un biomarqueur est un changement observable ou mesurable au plan moléculaire (génétique, biochimique), cellulaire ou physiologique dans les tissus ou les fluides d’un organisme ou sur l’organisme entier qui révèle l'exposition présente ou passée d'un organisme vivant à une substance chimique ou à un autre facteur de stress[2],[3]. Il révèle donc aussi la présence actuelle ou passée de polluants dans l'environnement et/ou l'impact de certaines pratiques. Ce peut être par exemple le nombre de poissons dans un lac, la quantité et le type de lichens sur les arbres d'une forêt, la couleur du pelage des animaux ou un taux anormal d'hormone de stress ou d'un enzyme de détoxication dans un organisme. Dans le domaine médical, un biomarqueur peut être utilisé pour le dépistage médical (recherche d'une maladie dans une population), le diagnostic (caractérisation d'une maladie chez un individu), la réponse à un traitement médical, la rechute après un traitement, la toxicité d'une molécule. Le biomarqueur est alors le plus souvent une protéine (dosable dans le sang ou la présence d'une molécule dans l'urine). En écologie et en écotoxicologieTypes de biomarqueursLe principe de l'utilisation d'un « biomarqueur » est de rechercher la signature biologique de l'impact (actuel ou passé) ou de la présence d'un xénobiotique dans l'organisme, ou de l'effet induit d'un changement ou stress environnemental (ex. : pollution thermique, pollution lumineuse induisant, déshydratation, perturbateur endocrinien..), et non la mise en évidence directe de la cause. Certains biomarqueurs (ex. : cerne des arbres...) révèlent des évènements anciens (contact avec un toxique, un pathogène, un évènement climatique...). Parmi les avantages de l'usage des biomarqueurs en écotoxicologie, on peut citer la rapidité de leur mise en œuvre, la détection précoce de la contamination, une utilisation possible à la fois au laboratoire et sur le terrain. Par ailleurs la technique peut donner une information relativement précise sur la nature des substances induisant la réponse[4]. Exemples de biomarqueurs Dans les milieux aquatiques d'eau douce, les premiers biomarqueurs ont été développés sur les poissons. Par exemple, l'activité enzymatique EROD (EthoxyrÈsorufine-o-dÈÈthylase) chez certains poissons (cyprinidés) a été proposée comme biomarqueur de la présence de polluants de type HAP, PCB et dioxines. Grâce à ce biomarqueur, les cours d'eau français peuvent être suivis ponctuellement (pour vérifier si une pollution accidentelle a eu des impacts par exemple) ou en utilisant ces poissons comme sentinelles à long terme (analyse en routine)[5]. Plus récemment dans les années 2010, de nouveau biomarqueurs ont été développés chez les espèces d'invertébrés présentes ou artificiellement implantées dans le milieu. Chez le gammare (Gammarus fossarum)) petit crustacé commun dans les rivières, par exemple, des biomarqueurs ciblant trois modes d’action de contaminants - neurotoxique, reprotoxique et génotoxique - ont été élaborés[6]. Le premier biomarqueur concerne le suivi de l’activité de l’acétylcholinestérase[7] (Ache), enzyme impliquée dans le transfert de l’influx nerveux. Le second biomarqueur consiste à mesurer la synthèse de la vitellogénine, une protéine synthétisée normalement par les gammares femelles, mais présente sur des mâles ou des juvéniles exposés à des contaminants a effet reprotoxiques[8]. Enfin, le "test des comètes" qui permet de quantifier le taux d’ADN endommagé dans les cellules d’organismes contaminés, a été mené sur l’ADN des spermatozoïdes de gammares[9] . Pour ce dernier type de biomarqueur, des tests réalisés dans les cours d’eau ont montré des taux d’endommagement de l’ADN pouvant atteindre 20 %. Les conséquences se mesurent ensuite sur la viabilité des embryons issus du croisement de cellules contaminées. Finalement, l’avenir des populations locales est menacé[9]. Aujourd'hui certains de ces test sont exploitées par l'entreprise BIOMAE[10], créé par Guillaume Jubeaux à l'issue de sa thèse[8] menée à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) (aujourd'hui Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) D'autres espèces invertébrés sont suivies dans les milieux d'eau douce, comme la moule zébrée (Dreissena polymorpha) ou l'hydrobie des antipodes (Potamopyrgus antipodarum), deux espèces invasives présentes dans la plupart des cours d'eau européens. En médecine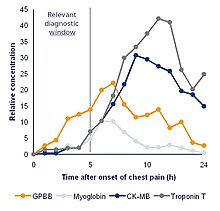  Historique de quelques biomarqueursEn 1948, la chaine légère de l'immunoglobuline est identifiée comme étant présente chez 75 % des patients atteint d'un myélome (Protéine de Bence-Jones). En 1963, G.I. Abelev découvre l'alpha-fœtoprotéine. Le dosage dans les liquides biologiques de cette molécule, permet de déceler la présence de cellules tumorales. En 1965, Samuel O.Freedman et Phil Gold, découvrent l'antigène carcino-embryonnaire (ACE), une substance sécrétée par les cellules d’une tumeur cancéreuse[11]. En 1981, le CA 125, marqueur dans le cancer de l'ovaire, est identifié par RC Bast[12]. La recherche de biomarqueursQuelques précisions sur l'utilisation du terme « clinique » et ses différentes utilisations sont nécessaires[réf. nécessaire] :
La découverte de nouveaux biomarqueurs est souvent liée au développement d'une nouvelle technologie, par exemple, l'alpha-fœtoprotéine et de l'antigène carcino-embryonnaire après le développement des techniques immunologiques. Actuellement, des techniques telles que les biopuces ou la protéomique semblent offrir de nombreuses perspectives[14]. Le EDRN[15] recommande un processus en 5 étapes pour le développement d'un biomarqueur[16] :
Valider un biomarqueur reste un processus long et complexe, ce qui explique leur faible nombre en routine. Pour faciliter l'utilisation des biomarqueurs en cours de développement dans des études cliniques, le centre d'Oxford EBM[17] a décrit une classification des biomarqueurs en fonction de leurs niveau de preuve[18][source insuffisante] :
RechercheLes biomarqueurs suscitent un intérêt croissant. Par exemple, en Allemagne, pour mieux détecter les signes prédictifs ou précoces de certaines maladies (cancer de la vessie ou du foie, maladies d'Alzheimer ou de Parkinson), le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RNW) propose 37 millions d'euros pour créer un « Centre de recherche sur les protéines » dit Pure (Protein Research Unit Ruhr within Europe) sur le Campus-Santé RNW de l'Université de la Ruhr à Bochum)[19]. Autre exemple, Ellen Jorgensen, de 2001 à 2009, comme directrice de la recherche et développement de biomarqueurs à Vector Research, publie ses travaux, en particulier les premiers biomarqueurs des maladies pulmonaires liées au tabac[20] . Notes et références
Voir aussiArticles connexesLiens externes
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
